Paru dans le R.L. du 04/05/2021
mardi 4 mai 2021
Des Montigniens habitant la rue Paul-Simminger vont bientôt voir fixé sur le ban communal un Stolperstein. Il s’agit d’un petit pavé en laiton. La ville, par ce geste, rappellera que ce fut un héros martyr du régime nazi qui n’a pas hésité à le juger, et à le condamner à mort le 27 janvier 1943. La famille de Paul Simminger. (photo Montigny Autrefois)
La famille de Paul Simminger. (photo Montigny Autrefois)
Paul Simminger travaille avec son père et ses trois frères dans l’atelier de vitrerie d’art installé au 114, rue de Pont-à-Mousson. Il n’échappe pas à la mobilisation de 1939. Il est fait prisonnier à Calais, transféré à Königsberg, en Allemagne. Il est libéré en tant qu’Alsacien-Lorrain. Fin 1940, il est expulsé de Montigny, entre en contact avec le groupe de résistance L’Espoir Français à Nancy, qui travaille pour le compte du réseau de renseignements clandestin Kléber Uranus. L’Armistice n’est pas encore été signé.
Le but de l’Espoir Français est de conserver le souvenir de la France, de garder et réveiller les sentiments pro-français de la population, d’affirmer l’appartenance de la Moselle à la France et autant que possible de nuire à l’Allemagne et d’aider à la victoire des armées de la France libre de Charles De Gaulle.
Arrêté le 8 juillet 1941
Chargé des liaisons avec les antennes du réseau en zone interdite, Metz notamment, il est arrêté le 8 juillet 1941 à la suite d’une dénonciation. Il est déporté au camp de Hinzert. Inculpé de haute trahison avec 18 autres membres du groupe L’Espoir Français, il est transféré à la prison de Trèves où il est jugé et condamné à mort par le Volksgerichthof (tribunal du peuple). Il subit l’odieuse sentence sans faiblir et sans avoir parlé.
Décapité en 20 secondes
À Cologne, le 30 juillet 1943, le bourreau est absent. C’est donc le premier contremaître mécanicien Hacker, aidé par l’aspirant au poste de bourreau Hans Mühl, qui décapite les trois condamnés : le docteur Bricka de Toul, Paul Simminger de Montigny-lès-Metz, Roger Noël de Nancy et ce en 23 secondes pour le premier et 20 secondes pour chacun des deux autres. Cela après lecture, par l’interprète Engeslhardt de la Gestapo, du jugement du tribunal du peuple, venu de Berlin à Trèves pour les condamner à mort en date du 27 janvier 1943.
Le corps mutilé de Paul Simminger repose dans le cimetière Litaldus de Montigny. Il a été élevé au grade de lieutenant, titulaire de la mention Mort pour la France. Il a reçu la médaille de la ville, la croix de chevalier de la Légion d’honneur et la Croix de guerre avec palme. Le tout à titre posthume.
En hommage à ce héros, les Montigniens vont bientôt voir fixé sur le ban communal un Stolperstein. Il s’agit d’une « pierre d’achoppement », c’est-à-dire une « pierre sur laquelle on trébuche ». Les Stolpersteine sont une création de l’artiste berlinois Gunter Demnig.
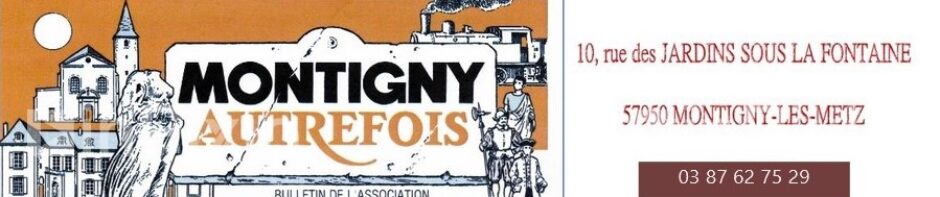

 Les serres du Jardin botanique de Metz vont être restaurées. Photo RL /Karim SIARI
Les serres du Jardin botanique de Metz vont être restaurées. Photo RL /Karim SIARI Clichés des serres de l’exposition universelle de 1861. Photo DR
Clichés des serres de l’exposition universelle de 1861. Photo DR Des travaux sont prévus sur la façade et les verrières des serres. Photo RL /Karim SIARI
Des travaux sont prévus sur la façade et les verrières des serres. Photo RL /Karim SIARI Les essences sont fragiles, les travaux des serres sont donc soumis au rythme des saisons. Photo RL /Karim SIARI
Les essences sont fragiles, les travaux des serres sont donc soumis au rythme des saisons. Photo RL /Karim SIARI










